Little Red Corvette
Baby, you’re much too fast
Yes, you are
Little Red Corvette
You need to find a love that’s gonna last
Prince, Little red Corvette
Il y a quelques mois, alors que je demandais à Matthias Hossann quelle serait l’ampleur de la révolution pour le conducteur quand il aurait l’hypersquare développé sur la prochaine 208 entre les mains, il me répondit que, tout de même, quelques « gestes héritage » demeureraient. C’était juste assez précis pour que je comprenne que les commodos ne disparaîtraient pas absolument, juste assez vague pour que cette survivance soit présentée de façon presque spirituelle. Et à vrai dire, il est possible que le maintien de quelques commandes classiques ne soit pas dû qu’à une mesure d’économies. Chez les marques historiques qui ont réussi à maintenir une forme de continuité dans leur production et dans leur esprit, il est normal qu’on entretienne ce fil, cette ambiance, cet ancrage dans le passé, et qu’on respecte un certain nombre d’habitudes, visuelles et pratiques, qui font qu’un modèle appartient à une lignée, à une famille, qu’il permet à ceux qui le choisissent comme compagnon de route de retrouver, de décennie en décennie, un univers familier dans lequel on a des repères fixes et fiables. Et dans son usage, qu’elle nous passionne ou pas, l’automobile est un objet qui accompagne nos vies. On y a été transporté enfant, on en a été longtemps passager avant d’en prendre le volant, on y a passé suffisamment de temps pour en avoir observé tous les aspects, on en a tout regardé, touché toutes les surfaces, épousé les courbes, les angles, les interstices entre les éléments, on en reconnaît les sons, les vibrations, l’électrochoc du démarreur, le chuintement de la clim, le sifflement du turbo, on devine à l’avance le décrochage d’un des trains roulant, le déclenchement de l’ABS. Même sans être au volant, on a suffisamment l’habitude de ce spectacle synesthésique pour y participer corps et âme dès qu’on boucle la ceinture, quel que soit le siège sur lequel on se pose.
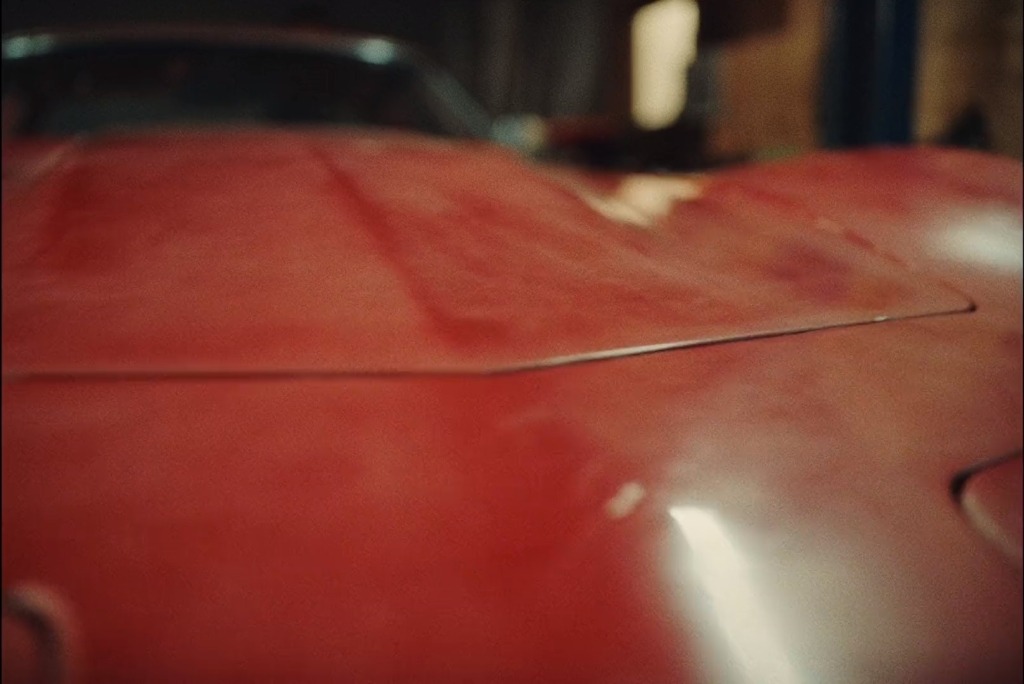
Mais si les modèles d’une marque essaient de former une famille, les conducteurs en forment une autre. L’automobile, c’est une histoire de transmission. Du moteur aux roues, mais aussi d’une génération à la suivante. Cette histoire humaine est faite de déplacements, de trajets et de voyages qui nous lient à celles et ceux qui nous ont conduit, qui nous ont embarqué, qui nous ont fait prendre la route en prenant le volant. On les a vus faire, on a observé leur façon de s’installer, leur prise en main, 10h10 ou 7h20, à deux mains ou une seule, coude à la fenêtre ou plus rigoureusement, les bras semi-fléchis bien parallèles l’un à l’autre. On a étudié la façon dont, savamment, ils chargeaient le coffre, le toit et tous les espaces encore disponibles avant les départs en vacances, on était à leurs côtés quand il fallait faire le plein, changer une roue, ouvrir le capot pour aller vérifier tel ou tel organe dans les tréfonds de la mécanique. On a appris avec eux la courroie d’accessoires, les bougies, la pompe à essence, les bornes de la batterie, et toutes les particularités qui font que la voiture dans laquelle on roule n’est pas identique aux autres. On à peu à peu compris le rythme du renouvellement, l’attachement familial à telle marque plutôt qu’aucune autre, l’importance accordée à la voiture, le soin mis à la laver régulièrement, ou au contraire à la laisser dans le jus de son usage quotidien pour que s’y accumulent les vestiges de la vie passée en sa compagnie, les témoignages de l’histoire familiale à travers le temps sous forme de kleenex oubliés, d’emballages de friandises et bouteilles à moitié vides, un bonnet par-ci, un drap de bain par là, des brochures de lieux visités, des cartes routières, les jouets du chien, sa couverture, un carnet de correspondance vieux de trois ans avec les bulletins trimestriels qu’on cherchait partout, des ordonnances, des tickets de cinoche, des factures de garagistes, stockées, là, parce que ça paraissait plutôt logique quand-même. Parce qu’elle est une seconde maison, la bagnole est le lieu où s’écrit une histoire parallèle dont le paysage est l’ailleurs.
L’auto reçue en héritage, la bagnole réceptacle d’un leg transmis d’une génération à une autre, c’est le cœur du film d’Ethan Milner, intitulé The Relics. Il faut croire qu’il se passe quelque de bien au sein des réalisateurs chrétiens : après Matthew P. Rojas, qu’on ne cesse de chroniquer ici, c’est un de ses coreligionnaires qui s’illustre dans la mise en scène du passage de relai entre un père et – une fois n’est pas coutume – sa fille. Que les objets inanimés n’aient pas d’âme, soit. Mais les bagnoles sont un autre genre d’objets, qui semble bien disposer de l’aptitude à se mouvoir. Ce sont des machines, pas des outils. Non seulement ils s’animent, mais en plus ils induisent chez ceux qui les côtoient des mouvements qu’ils déterminent parce qu’il faut bien s’adapter à leur configuration particulière : soulever le volet battant d’une fenêtre de 2cv, ce n’est pas le même geste que l’ouvrir d’un appui simple sur un interrupteur ou d’une rotation de manivelle. Déverrouiller un capot et laisser les vérins se charger de le soulever vers l’arrière ce n’est pas le même geste que le saisir à deux mains pour faire le basculer vers l’avant. Chaque aspect d’une voiture contraint à adopter des postures, une gestuelle, des attitudes, autant d’éléments d’une sorte de rituel quotidien qui définissent la façon dont, avec cette voiture précise, on devient automobiliste. Ainsi, confier sa automobile à quelqu’un d’autre, c’est transmettre toute une culture faite de la connaissance intime de ce modèle précis qu’on lègue, du savoir-faire lié à sa conduite et à son entretien, du savoir-vivre que cette voiture impose à ceux qui veulent partager sa vie, laisser chauffer un peu avant d’engager la première, faire tourner le moteur au ralenti quelques secondes avant de couper le contact, donner un petit coup de gaz au passage de la quatrième.

La gestuelle dont on a hérité, c’est l’injection dans son propre corps d’une chorégraphie que d’autres ont exécutée avant soi. Et si les voitures anciennes sont plus riches en héritage sur ce point, c’est parce qu’elles étaient moins assistées. Contracter une tendinite de l’avant bras à cause d’une commande de boîte récalcitrante, enfoncer très précisément le bouton d’ouverture du coffre, ni trop peu, ni trop non plus sinon ça s’ouvre pas, ouvrir la boîte à gants et y enfoncer la main pour, du bout de l’index trouver la commande d’ouverture de la trappe à carburant, à moins qu’il faille basculer la plaque d’immatriculation pour découvrir le bouchon du réservoir, autant d’habitudes du quotidien, auxquelles on ne fait attention qu’une fois qu’on n’a plus l’occasion de les accomplir, dans les autres voitures, comme si soudain on était en terre étrangère, là où les us et coutumes qu’on respecte d’habitude n’ont plus lieu d’être. Une voiture est une langue, qu’à bord d’une autre on ne parle pas.
The Relics est un hommage à ce qui, par la transmission d’une voiture, ressuscite ce qu’un père disparu et sa fille en deuil avaient partagé, le temps de leur vie commune, autour d’une bagnole. Pas n’importe quelle bagnole quand-même. Une Corvette Stingray. Une survivante des seventies. Rouge. Comme il se doit. La peinture tannée par les années, magnifiquement dépouillée de son vernis originel ; comme passé à la sableuse du temps. Le mini-métrage d’Ethan Milner se déroule dans une espèce de Jardin d’Eden mécanique, un atelier comme on n’en fait plus, plein de chiffons sur lesquels se sont essuyées des mains de mécanos plongées des jours durant dans la graisse cramée de moteurs ancestraux, un cambouis longuement maturé le long des durites tièdes, des échappements brûlants, de piles de cartons de pièces détachées, d’amoncellements de pièces détachées sans carton, sans référence parce qu’on n’en a pas besoin, on les reconnaît de vue comme on connaît par cœur le lobe de l’oreille de son enfant, qu’on ne confondrait avec aucun autre. Et son bureau, sa paperasse laissée là pour plus tard, quand le boulot serait fait, son ordinateur acheté au moment où, vraiment, on ne pouvait plus faire autrement, ses souvenirs en pagaille, mêlant vies professionnelle et familiale parce que, vraiment, c’est une seule et même vie, les ouvriers comme des neveux, les clients comme des cousins, les fournisseurs comme des parents éloignés auxquels on doit quelque chose, parce que tout ça se situe quelque part entre l’art et le commerce. De l’attention, du respect, du temps passé à cogiter pour résoudre la panne au mieux, trouver ou reconstruire une pièce, faire au mieux, au prix le plus juste. Faire vivre sa famille sans dépouiller celle des autres et regarder avec fierté les bagnoles entrer en crachant leurs glaires grasses dans la fosse et repartir en respirant à pleins poumons.

Un garage et sa contre allée, à l’abri des regards, comme une cour intérieure dans laquelle on a parqué la Corvette, délaissée parce qu’on fait passer le client avant soi-même, la restauration de la raie écarlate repoussée à un plus tard désormais située dans l’au-delà de sa propre vie. Au-delà d’une certaine limite, votre ticket n’est plus valable. Alors la bête sommeille sous une bâche, même pas vraiment protégée de la pluie, comme si un linceul avait été déposé sur tout ce qui pourrait témoigner de la présence de celui-ci qui manque désormais à l’appel, un voile pudique tendu sur l’absence avec pour paradoxal effet de la mettre en évidence, au point de ne plus voir que ça.
L’électrocardiogramme et l’oscilloscope sont frères de courbes sinusoïdales. Ce sont les témoins de cette aptitude au mouvement qu’on appelle parfois « la vie ». Tout effort tente d’arracher la matière au calme plat, de l’extirper du repos éternel vers lequel elle tend. Tant qu’on n’est pas soi-même mort, il faut bien s’accrocher à tout ce qui peut rester de vie. Et quand celle-ci ne s’incarne plus dans le corps on la cherche dans tout ce que le corps a touché, ce qu’il a tenu en mains, ce dont il a pris soin au point de le soigner pour que ça marche encore un peu, tout ce qu’on peut saisir à son tour pour poser la main là où ses mains se sont posées, manipuler ce qu’elles ont manœuvré, soulevé ce capot, ouvrir cette porte, s’asseoir dans ce siège comme, avant, il s’y est assis, il a tiré vers lui cette poignée, hissé ce capot à la verticale pour dévoiler ce V8 dans lesquelles ses mains étaient plongées, ces entrailles au creux desquelles on cherche à son tour le cœur qui pourrait battre de nouveau.

Il y a quelque chose d’Insterstellar dans le film d’Ethan Milner. Dans la façon dont Joseph Cooper confie son pick-up en héritage à Tom son fils, dans la façon dont un père hante une bibliothèque, ou des étagères remplies de pièces détachées, dans le poème planant en voice-over sur les images. Dylan Thomas chez Nolan, Mary Elizabeth Frye chez Milner. Deux poèmes adressés depuis l’au-delà à celle qui reste, à celui qui se retrouve seul dans la vie, héritier d’une existence dont il ne savait encore que théoriquement à quel point elle serait de plus en plus solitaire. Deux messages de prévention : « Do not go gentle into that good night », « Do not stand by my grave, and weep’. Deux bouées lancées depuis l’eau-de-là vers l’océan de l’ici. Comme un livre qui tombe du rayonnage, un démarreur roulant à travers l’atelier jusqu’aux pieds de celle qui saura quoi en faire. Pour celle qui reste, tout devient signe, le moindre phénomène devient message et la vie n’est plus qu’une interprétation sans fin de signaux faibles, qu’aucune autorité ne pourra attester. Regarde autour de toi, plonge dans tes souvenirs et démerde toi.
Les lieux choisis par Ethan Milner sont volontairement dépeuplés : le garage familial la nuit, déserté par les clients et les mécanos, une cimenterie abandonnée. Si les âmes errent quelque part, ça ne peut être que dans les interstices du monde, là où personne ne se rend plus ou à défaut, aux horaires non ouvrés. C’est dans la marge de l’existence qu’on peut les rencontrer. Réduites au statut de témoin, nécessairement assistées, elles peuvent tout au plus s’asseoir à la place du mort, approuvant d’un regard transparent le passage du relai. Joseph Cooper a cette intuition avant de se figer dans le temps à un âge encore jeune que sa fille dépassera plus rapidement qu’elle ne pourrait elle-même le croire. Dès qu’on a des enfants, on n’a plus qu’une seule mission dans la vie : devenir pour eux un souvenir.

Les objets n’ont que l’âme qu’on leur prête, ou qu’on leur reconnaît. Si on sent en eux une pulsation vitale, c’est qu’ils ont été auparavant chargés de cette énergie, comme un sous-pull en acrylique emmagasine quand on l’enfile l’électricité qui fera ensuite crépiter les cheveux alors qu’on le retire. Les objets sont les livres en braille dans lesquels on lit du bout des doigts l’histoire de nos prédécesseurs. Dans les rituels qui nous lient aux défunts ils sont les intermédiaires liturgiques qui convoquent les âmes en ce bas-monde, les invitent à se manifester et les révèlent. On peut tourner la clé dans le neiman et lancer le démarreur comme on récite une prière. Engager la première et embrayer comme on fait parler les morts. Ceux-ci agissent à travers nous. A bord d’une Corvette rouge sang séché, ce n’est pas tout à fait mon bras qui pousse le levier sur la position Drive, ni tout à fait mon pied droit qui pousse sur la pédale. C’est le bras conjoint au mien de celui qui a conduit ce coupé avant moi et en a fait ébrouer le V8 sur la route, ce sont nos pieds qui, indissociables, épousent l’accélérateur et libèrent cette puissante barque au beau milieu du Styx.
Quand une fille menant désormais seule sa vie prend le volant des mains de son père, c’est comme si soudain elle éprouvait ce que signifie le mot descendance. Recevoir le mouvement de ceux qui nous ont précédé, c’est avoir enfin de qui tenir. Cette transfiguration, Ethan Milner la figure par un simple changement de cadre, à la façon dont Xavier Dolan joue du cadre de l’image comme un élément du récit de Mommy. C’est en acceptant que le mouvement nous échappe qu’on peut en conserver quelque chose. Tout ne disparaît pas car le temps nous traverse et nous agissons sur lui comme un tamis qui conserve ce qui mérite de l’être. Ces résidus, ces sédiments sont la matière dont on est fait. Nous ne sommes que des souvenirs en puissance ; ceux des autres en nous, les nôtres chez ceux qui nous succèderont. Tout arbre généalogique est avant tout un arbre de transmission. Il y a dans ce genre de voiture des forces qui dépassent la cylindrée et le rapport poids/puissance. Si, comme le prétendaient les grecs, les dieux sont dans la cuisine, il y a aussi quelque chose de spirituel dans l’art mécanique, un Ghost in the Shell flânant entre le moteur et le volant. Dans une ancienne, on n’est jamais tout à fait seul au volant. Conduire, c’est être conduit.
