Cobranding
La pub est une charogne qui nous sourit. La formule n’est pas de moi, elle vient d’un des maîtres en la matière, Oliviero Toscani, qui concevait, jadis, les campagnes publicitaires choc de la marque Benetton. En fait, cette formule magique du cynisme (aujourd’hui, on dirait plutôt, du pragmatisme) était tellement assumée chez lui qu’il s’agit du titre du livre dans lequel il tente de trouver une légitimité intellectuelle à sa pratique. Et disons que, dans le cadre de son activité, tout ceci est légitime. Bon, en réalité, si on ne place les choses que dans le cadre restreint de sa propre pratique, alors tout devient légitime, puisqu’on a toujours une raison de faire les choses, et dans la perspective de cette action, cette raison est toujours bonne.
Mais bref.
Ce qui compte après tout, c’est donc que la publicité nous sourit. C’est à dire qu’elle nous séduise. La séduction, c’est un principe intéressant. Se-ductere, en latin, ça signifie tirer vers soi. En langage automobile, on pourrait dire, tracter. C’est un peu le principe de la ceinture d’Aphrodite : celle-ci tirait sa séduction non pas de son corps, mais de la ceinture qu’elle portait. Elle plaisait donc de façon artificielle, parce que sa ceinture, en resserrant le vêtement au niveau de sa taille, faisait ressortir ses formes qui, sinon, étaient effacées par le tomber du tissu de sa tunique. Ainsi, l’artifice de séduction sert à dévoiler sans déshabiller. Il est un peu faux-cul en somme, mais il sait par où nous saisir pour nous mener par le bout du nez.
On veut une illustration ?
Hier, je suis tombé par hasard sur une publicité Nescafé. Evidemment, comme c’était sur le net, ça n’a rien à voir avec un quelconque hasard. D’une part parce que celui-ci n’existe pas (tout est déterminé), d’autre part parce que celui-ci existe encore moins en matière de marketing. Tout y est intentionnel. Donc, dans la bannière se trouvant en haut de je ne sais plus quelle page, sur le net, défile une publicité nescafé. Ou plutôt, dans cette bannière défile une publicité que je n’identifie pas tout de suite comme étant une publicité Nescafé, parce que l’objet omniprésent dans ce micro-métrage, c’est une voiture, et pas n’importe laquelle; c’est LA voiture sympathique par excellence : le break Volvo 240. Celui des années 80, la sympathie faite automobile.
Trois précisions s’imposent :
– Je ne sais pas si c’est un 240, un 242, ou un 245. Tout en adorant cette bagnole, je n’arrive pas à en distinguer les versions, et ce d’autant moins que selon les marchés, les phares, les calandres et tout l’accastillage (les bandes de protection, le matériau des pare-chocs) semblent interchangeables. Et je pense que ceux qui sont le plus fermement attachés à ce modèle précis sont tout aussi incapables que moi de les distinguer, parce que ce n’est pas une voiture qu’on adore pour l’amour de ce qu’elle est automobilistiquement. C’est plutôt un modèle qu’on aime pour l’usage qu’on en a, et peut-être même parce qu’il exprime le fait qu’on n’en a rien à foutre des voitures. Et c’est ça qui est génial, tellement génial que ça ne pourra a priori pas être reproduit : avoir créé la voiture parfaite pour ceux qui ne sont absolument pas intéressés par les voitures. Et l’avoir fait tout en concevant, finalement, une voiture passionnante, et attachante (parce que, sinon, on peut aussi rouler dans une berline japonaise des années 90, mais c’est pas tout à fait la même histoire).
– La sympathie de ce modèle me semble venir en grande partie de l’histoire de sa représentation dans de multiples fictions, qu’elles soient cinématographiques, clipesques, ou publicitaires. Peu à peu, la brique Volvo est devenue la bagnole de ceux qui font des virées dans les zones prémontagneuses et boisées, l’hiver, quand tout est bien bien humide. C’est la voiture dans laquelle on dort, celle dans laquelle on peut même quasiment vivre, parce qu’elle est grande (elle est étroite, mais longue, on dirait un peu une longère normande), parce que rien ne craint vraiment à l’intérieur, tout est à l’épreuve de l’usage. On peut s’y installer franchement, sans chichi. Du coup, c’est carrément devenu la bagnole idéale des homeless, des trailer-parks, des travailleurs pauvres qui s’en servent comme refuge. A tel point que, finalement, on pourrait dire que le refuge, c’est l’essence même de Volvo, contre le reste du monde. La sympathie, c’est l’aptitude à partager la souffrance d’autrui, son pathos. C’est une sorte de contagion affective qui fait reconnaître, et même ressentir ce qu’éprouve l’autre rien qu’en le voyant, à partir de signes extérieurs. Eh bien ce break Volvo en particulier est porteur de ceci : il est le signe de ceux qui ne souhaitent pas paraître (mais comme il est un signe, du coup, il devient le signe de ceux qui ne veulent pas paraître pour des gens qui se soucieraient de paraître; ou disons le autrement, il est le signe de ceux qui souhaitent paraître comme ne se souciant pas de la façon dont ils paraissent – bref, on n’en sort pas), il est la bannière de ceux qui sont porteurs d’une souffrance, et si ce n’est pas un problème économique, ça pourrait être un manque d’adaptation au monde de la performance, ou une espèce de nostalgie, de vague à l’âme, on repère en somme tout de suite chez celui qui roule en break 240 une distance qu’on a envie de combler, tout en se retenant de le faire pour ne pas briser quelque chose de précieux, pour ne pas effrayer en étant trop présent. C’est une refuge contre le monde, mais voila, on fait partie du monde, on ne peut donc pas s’approcher trop vite, trop près, sans entrer dans une sphère d’intimité dont les portes lourdes de cette voiture constituent la frontière.
– La calandre de la voiture est effacée par la publicité. Ce qui n’a pas grand sens puisqu’elle est ultra-reconnaissable. C’est d’ailleurs un des talents de Volvo : avoir su créer des formes simplissimes, mais immédiatement identifiables. Le volume général de l’auto, reconnaissable en tant que silhouette, les appuis-tête, carrément iconiques, le tableau de bord, dessiné à la règle et à l’équerre, les blocs optiques, les pare-chocs, tout est précisément Volvo. Et derrière un physique dessiné par la banalité, il y a l’impossibilité de la perte d’identité, comme si être à ce point commun n’était finalement pas donné à tout le monde. Et chez Nescafé, on est manifestement totalement conscient de ce phénomène.
Parce qu’après tout, l’analogie entre le café et cette voiture fonctionne à plein régime. Le café, c’est un truc qui se partage, c’est modeste (ce n’est que de l’eau chaude aromatisée avec une poudre), ça n’a rien de prétentieux, ça n’épate pas la galerie. C’est commun, banal. Du coup, comme ça ne coûte rien, ça s’offre. Et puisque ça s’offre, ça témoigne d’un souci de l’autre. Offrir un café, c’est réchauffant, et c’est réchauffant de sentir que quelqu’un d’autre puisse se soucier de nous réchauffer. Du coup, le café, c’est un partage qui va plus loin que le simple fait de verser de l’eau aromatisée dans un mug. Le café, c’est un refuge. A tel point que le mot est en lui-même métonymique : le café est aussi bien la boisson qu’on consomme que le lieu dans lequel on se le fait servir.
Valeur refuge
Alors, la Volvo, parce qu’elle est refuge, est comme un café.
Mais si le café est cela, quel besoin peut avoir Nescafé de le rappeler avec une telle insistance, en prenant même le risque de voir sa campagne vampirisée par la métaphore qu’elle met en scène ? Parce que Nescafé, c’est aussi Nespresso. Et que le café Nespresso est tout le contraire de tout ce qu’on vient d’évoquer. Nespresso, c’est Clooney, la distinction, l’exclusivité, le chichi des boutiques, la mise en scène de la cafetière qui migre du plan de travail dans l’arrière cuisine pour s’installer dans le salon. C’est le café hyper cher, c’est une certaine arrogance, le premium. Ce n’est même plus le café, c’est nécessairement un café, puisqu’il faudra que chacun choisisse la variation proposée dans la vaste gamme des déclinaisons de ce qui, à l’origine, était censé être un breuvage générique. Du coup, on se retrouve à ne plus boire le même. Donc, ce n’est plus un partage mais un exercice de distinction.
Le problème de Nescafé, c’est que sa gamme prétentieuse ayant connu le succès, prononcer la première syllabe, c’est immédiatement avoir « Nespresso » en tête. Le slogan « what else ? », précédé du nouveau nom a effacé, dans les mémoires, le nom de famille, trop commun, trop populaire pour être valorisé dans un monde qui ne vise que le haut de gamme. Nescafé, c’est un comme Ricoré, le nom de l’ami du p’tit déj’. Et à une époque où on embarque son Mug thermos dans la bus pour se donner un air sur-occupé (je n’ai même pas le temps de prendre un café à la maison…), forcément, le côté « famille » du nom Nescafé a du mal à être valorisé publicitairement.
En fait, il s’est passé la même chose avec le café que ce qui s’est passé avec les barbecues. Au début, on a une espèce de bac en fonte avec une grille dessus, et ça semble convenir à tout le monde. Puis un jour, un voisin a acheté un Weber, qui coûtait 100 fois le prix d’un barbecue normal. Et c’était comme s’il avait lancé un message à tout le quartier : Ben quoi les gars, vous vous contentez du nécessaire ? Vous ne vous offrez pas ce qui se fait de mieux ? En somme, vous ne vous respectez pas ? Nespresso est au café ce que Weber est au barbeq’ : une façon de croire collectivement que boire de l’eau chaude est une expérience singulière. Ce qui en dit long sur l’altitude à laquelle plane cette singularité.
La publicité Nescafé est là pour nous rafraîchir la mémoire. La preuve, elle est carrément sponsorisée par l’ICM, l’Institut du Cerveau et la Moelle épinière. C’est dire à quel point, cette fois ci, ils ont pensé le truc. Parce qu’en fait, ça fait un moment que Nestlé tourne autour de cette idée de reconnecter le public avec la réalité. Il y a quelques années, ils avaient tenté de faire croire qu’une tasse de café permettrait de déconnecter les gens de leur smartphone, et les reconnecterait les uns avec les autres, dans la grande symphonie du partage d’eau chaude. Ça n’a pas pris. Du coup, là, on change de tactique : on ne cherche plus à couper les gens de leur écran. Au contraire, celui-ci est omniprésent. C’est simple, le récit tourne autour de trois objets : la Volvo, les écrans, et les mugs. Le café ? On n’en verra pas la couleur. A peine une vapeur en fin de spot. Il est absent. Et c’est normal : ce n’est que du café.
La permanence, jusqu’à l’obsession
Du coup, la publicité se trouve hors du temps : on utilise le smartphone en permanence, mais on roule dans une voiture des années 70-80. On publie sur un réseau social, mais c’est à usage familial. On est là, mais ailleurs aussi. En fait, il n’y a pas 36 solutions pour être à ce point là hors du temps : il faut se trouver dans l’espace de la mémoire. Et c’est bien ce qu’on signifie en mettant en scène le passé à travers les photos qui se trouvent en arrière plan de l’écran d’ordinateur : on y trouve la version passée des protagonistes, on y trouve celle qui n’est plus là, et la seule chose qui soit restée telle qu’elle : la Volvo, qui traverse le temps. Mais comme la Volvo, c’est comme un café, la valeur refuge, Nescafé n’a même pas besoin de montrer le père avec son mug sur le bureau : ce serait forcer l’esprit, et il est toujours plus efficace de laisser ce dernier faire le boulot lui-même. Plus on montre la Volvo, plus on pense au café, et au café tel qu’il traverse le temps, c’est à dire pas une capsule prétentieuse, mais ce réchauffement simple qu’on prend ensemble, pour se retrouver, dans la chaleur de la présence partagée.
Cette persistance du passé dans le présent permet au montage de jouer les flash-backs sans aucune rupture temporelle, puisque les retours dans le passé sont en fait des rééditions de celui-ci. C’est tellement bien fait qu’il y a un détail foiré dont on se demande si c’est vraiment un loupé, ou si c’est une énième astuce dont on n’aurait pas encore compris le fonctionnement : au moment où le père se lève pour aller accueillir ses invités surprise, le bureau n’est pas le même que sur les autres plans. Un livre s’y trouve qu’on ne retrouve ni avant, ni après, les photos sur le mur sont un peu différentes. Entre autres, la photo en noir et blanc, dont on ne sait si elle est le portrait du fils ou de sa mère, a disparu, et on n’est pas certain que ce soit bien la photo souvenir du père et de sa Volvo qu’on voit. Comme si le fait de quitter le lien que constitue l’écran avait pour effet un effacement au moins partiel de la mémoire qui affecterait, aussi, le monde présent. Ou alors c’est juste un faux raccord. Mais sachant à quel point on est minutieux dans la réalisation de ce genre de campagne, j’ai presque envie d’être parano et d’y voir un effet subtil, mais tangible, du montage sur la perception qu’on a du spot, une manière subtile, parce qu’imperceptible, de provoquer des affects; et c’est bien le but de toute publicité. Un détail permet de voir à quel point Nescafé veut jouer sur cette corde particulièrement sensible : le projet re:connect est en réalité plus vaste qu’une simple publicité, puisqu’il s’agit d’une application sur smartphone qui permet d’interagir avec le navigateur internet d’une personne précise, sur lequel on va pouvoir envoyer des contenus vidéo qui apparaîtront à la suite des publicités en ligne, sur la page de n’importe quel site. Une façon de se rappeler au bon souvenir de la personne qui verra soudain apparaître les auteurs de ces vidéos sur son écran, à tout bout de champ. On a compris le mouvement ? Il ne s’agit plus de déconnecter; mais d’être connectés en permanence, de ne plus jamais raccrocher, d’être en lien sans arrêt, comme une cafetière qu’on laisserait en permanence sur le feu, dans lequel chaufferait un éternel breuvage, qu’on pourrait servir n’importe quand, puisqu’il n’y a plus de temps. L’air de rien, tout en feignant de revenir à l’essentiel, Nescafé installe en fait une proposition qui consiste à confondre en permanence l’essentiel et son double, c’est à dire sa mise en scène. Comme si la mémoire n’exigeait pas, au moins provisoirement, l’effacement.
Il y a donc bien une charogne cachée sous le tapis. Un leurre, une ceinture d’Aphrodite. Et cette fois-ci, la charogne a la calandre effacée d’une brique suédoise qui sert de machine à voyager dans le temps, façon DeLorean. Elle me sourit, elle semble savoir quels liens imaginaires il y a entre ce break et moi. C’est par là qu’elle me tient. Elle me sourit, je la regarde. Elle me séduit. Je la suis dans l’arrière cuisine.
Merde, j’ai plus de filtres.
Où j’ai mis les clés de la Volvo ?
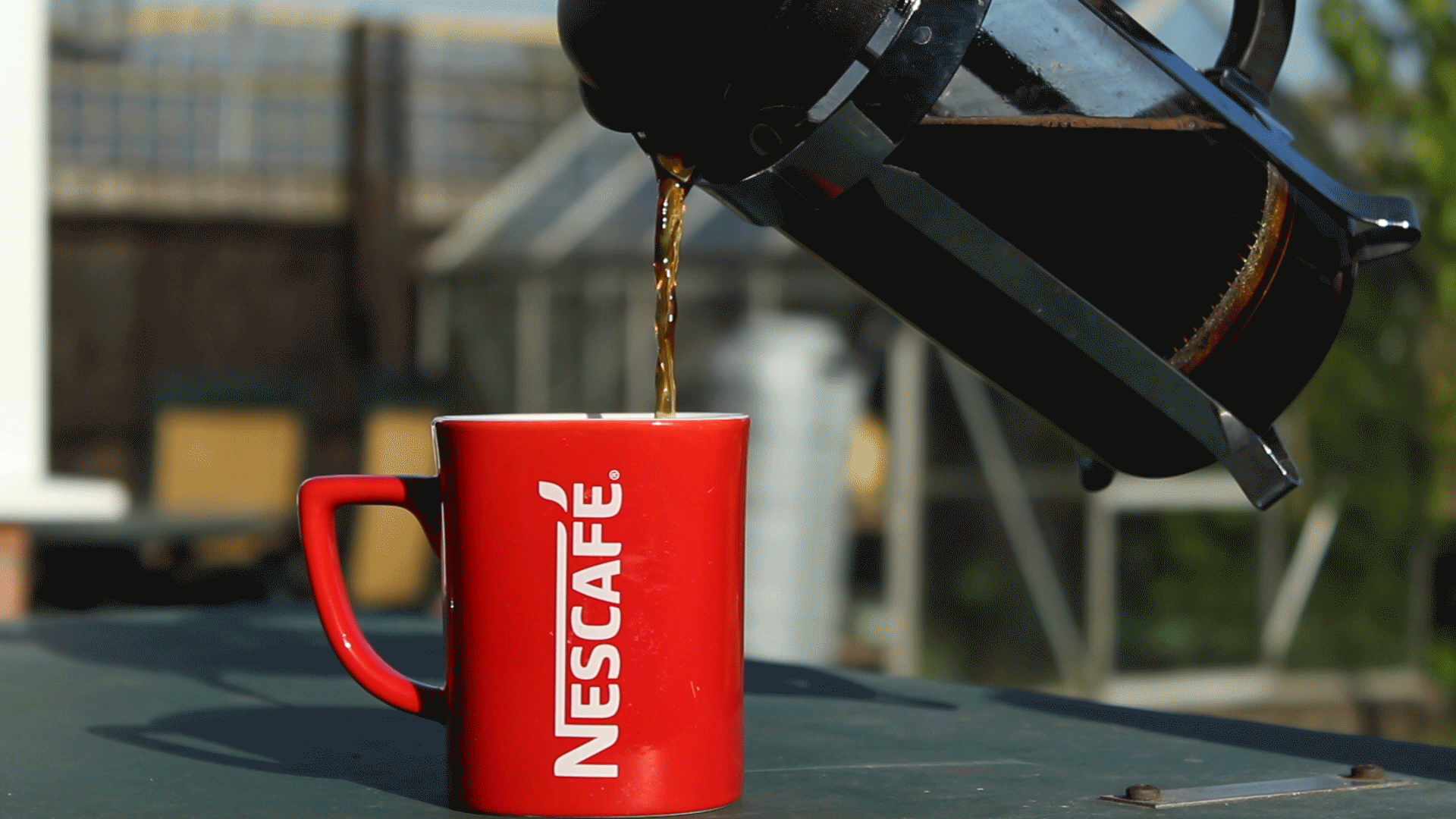
Au fait, vous avez mémorisé la définition de la séduction comme traction ? Regardez bien le cul de la Volvo, elle est équipée d’un attelage. Tout est pensé, je vous l’avais dit. Vous voila embarqué.
Sympa, belle description.
Merci !
Un de ces quatre, je vais faire une petite liste des apparitions cinématographiques, clipesques et publicitaires des breaks Volvo. Il n’y a que des belles choses dans ce répertoire, et ce sont autant d’univers qui mettent en valeur la beauté de ce modèle.
Bel éloge de la 240 ! Pour les différenciations 2, 4, 5, c’est simple, c’est le nombre de portes. 242 = coupé, 244 = berline et 245 = break. Ensuite Volvo a arrêté ce mode de dénomination et c’est devenu la 240 tout court. En effet, pas mal de prod’ de films qui cherchent ces break Volvo pour des tournages. Et sinon, sur Arte en ce moment, une série « Jeux d’influence »… Vous y verrez une 245 vert militaire.
une 242 (coupé donc) dans le tout début de « Retour vers le Futur »… vous qui parliez de voiture à voyager dans le temps
Merci pour les « trucs » de reconnaissance ! Et merci derechef pour le signalement, je n’ai pas repéré cette apparition en début de Retour vers le futur (du coup, entre la Volvo et la Delorean, mon coeur balance !).
Il ne faut pas l’ébruiter, mais je prépare un article, qui sera la chronique d’un de mes films préférés, qui se passe presque intégralement dans un break Volvo : Old Joy, qui met en scène un de mes chanteurs préférés : Will Oldham (aussi connu sous le nom de Bonnie « Prince’ Billy.