Nourris par les réseaux sociaux et les flux pré-programmés, nous regardons tous un peu les mêmes choses. Et même si j’essaie de dénicher des trucs qui n’ont pas encore été trop vus et revus, les plateformes vidéo sont comme toutes les routes menant, inexorablement, à Rome : nous finissons tous par voir le même clip, la même publicité, à peu près au même moment.
Evidemment, quelques jours après le Super Bowl, il est tentant de passer une semaine à ne chroniquer que les grands spots publicitaires diffusés à cette occasion, commandités par de très grandes marques précisément pour qu’on parle d’elles. Bien sûr, sans être dupe de ce processus, j’y participe. Et vous lirez dans les jours qui viennent des textes sur, bien sûr, la guerre déclarée par Will Ferrel à la Norvège, ainsi qu’une petite lecture de la campagne publicitaire en cours pour le Peugeot 5008.
Mais il est bon, aussi, de consacrer un peu de temps et d’acuité visuelle à des propositions plus locales, à des réalisateurs qui travaillent en partenariat avec des structures plus petites et parfois carrément familiales. C’est là, aussi, qu’on peut assister à du travail qui, tout en demeurant de dimension artisanale, manifeste le savoir-faire de ses auteurs, qui font pour leurs clients des produits sur-mesure, des petits métrages qui ont toutes les qualités des très grosses production, avec le charme des petits producteurs locaux en plus.
C’est le cas aujourd’hui avec un réalisateur qu’on avait déjà évoqué pour son spot vidéo tourné pour le compte de Motor Society, un site de vente en ligne de voitures qui ont la double et contradictoire caractéristique d’être comme neuves, et néanmoins anciennes. Revoici aujourd’hui Matthew P. Rojas avec un nouveau film, consacré cette fois-ci à la promotion d’un carrossier local, installé à Amarillo, ville suffisamment inconnue pour qu’on doive préciser qu’elle se trouve au Texas, au milieu de, en gros, rien du tout. Lokey’s Body Shop est un garage familial, spécialisé dans les travaux de carrosserie.
Lokey Mata ouvrit ce garage au milieu des années 80, et le fit prospérer jusqu’à passer la main à ses deux fils, Jason et Jayden, pour qu’ils poursuivent l’œuvre de leur père. Après tout, dès que le travail est bien fait, on peut parler d’œuvre. Peu importe qu’il s’agisse de carrosserie ou de théâtre. Socrate disait ceci : voir de belles choses invite à tenir de beaux discours. Du coup, Platon qui trouvait beaux les discours de Socrate a écrit à son tour de beaux textes qui parlent de la beauté des paroles de Socrate. C’est un peu la même chose ici : Matthew P. Rojas a vu le travail des frères Mata dans le garage créé par leur père, et c’est cette beauté qu’on retrouve dans son propre film.

A vrai dire, celui-ci n’est pas tout à fait étranger à la vague de spots qui nous tombe dessus à chaque Super Bowl, car il y a en fait des décrochages régionaux dans les plages publicitaires entrecoupant ce spectacle, et le spot de Matthew P. Rojas a été diffusé dans ce cadre plus restreint. Mais peu importe ici le caractère local de l’entreprise : le réalisateur a consacré autant de moyens et de talent à cette publicité que ce qu’il aurait pu déployer pour une plus grande marque.
Résultat : une galerie de portraits, et des beaux plans sur le fruit de leur travail. Il y a peu de choses plus belles dans ce monde qu’un travailleur, et Matthew P. Rojas sait regarder l’être humain lorsqu’il se confronte, dans la sueur et la fatigue, au monde qui est le sien, pour mieux le transformer ; et par la même occasion, se transformer.
Ce spot, à vrai dire, me remettait en tête l’introduction au beau livre de Matthew B. Crawford intitulé Eloge du carburateur, Essai sur le sens et la valeur du travail (La Découverte, 2010 (en v.o. : Shop Class as Soul Craft. An Inquiery into The Value of Work (Penguin Press, 2009))). L’auteur y revient tout d’abord sur le fait que, brusquement, on a vu apparaître sur le marché de l’occasion des machines outils professionnelles. La cause ? On a arrêté d’en enseigner la maîtrise dans les cursus scolaires aux USA. Dans les lignes qui suivent, on peut deviner pourquoi Lockey’s Body Shop est un garage familial : si Jason et Jayden Mata n’avaient pas reçu de leur père cet enseignement du rapport direct à la réalité, ce n’est pas au cours de leurs études qu’ils l’auraient appris :
« Si vous cherchez une bonne machine-outil, adressez-vous à Noel Dempsey, qui tient boutique à Richmond, en Virginie. Le magasin bien achalandé de Noel est plein de tours, de fraiseuses et de scies circulaires ; il se trouve que la plupart de ces outils proviennent d’établissements scolaires. On trouve également en abondance ce genre d’équipement sur eBay et, là aussi, il s’agit généralement d’objets en provenance de lycées ou de collèges. Cela fait près de quinze ans qu’ils circulent sur le marché de l’occasion. C’est en effet dans les années 1990 que les cours de technologie ont commencé à disparaître dans l’enseignement secondaire américain, quand les enseignants ont commencé à vouloir préparer leurs élèves à devenir des « travailleurs de la connaissance » (knwoledge workers).
La disparition des outils de notre horizon éducatif est le premier pas sur la voie totale de l’ignorance totale du monde d’artefacts que nous habitons. De fait, il s’est développé depuis quelques années dans le monde de l’ingénierie une nouvelle culture technique dont l’objectif essentiel est de dissimuler autant que possible les entrailles des machines. Le résultat, c’est que nombre des appareils que nous utilisons dans la vie de tous les jours deviennent parfaitement indéchiffrables. Soulevez le capot de certaines voitures (surtout si elles sont de marque allemande) et, en lieu et place du moteur, vous verrez apparaître quelque chose qui ressemble à l’espèce d’obélisque lisse et rutilant qui fascine tellement les anthropoïdes au début du film de Stanley Kubrick 2001 : L’Odyssée de l’espace. Bref, ce que vous découvrirez, c’est un autre capot sous le capot. Cet art de la dissimulation a bien d’autres exemples. De nos jours, pour dévisser les vis qui maintiennent l’ensemble des parties des appareils de petite taille, il faut souvent utiliser des tournevis ultraspéciaux qui sont très difficiles à trouver dans le commerce, comme pour dissuader les curieux ou les insatisfaits de mettre leur nez dans les entrailles de ces objets. Inversement, mes lecteurs d’âge mûr se souviendront sans doute que, il n’y a pas si longtemps, le catalogue Sears incluait des graphiques et des schémas décrivant les parties et le fonctionnement de tous les appareils domestiques et de nombreux autres engins mécaniques. L’intérêt du consommateur pour ce genre d’information passait alors pour une évidence.
Ce déclin de l’usage des outils semble présager un changement de notre relation avec le monde matériel, débouchant sur une attitude plus passive et plus dépendante. Et de fait, nous avons de moins en moins d’occasions de vivre ces moments de ferveur créative où nous nous saisissons des objets matériels et les faisons nôtres, qu’il s’agisse de les fabriquer ou de les réparer. Ce que les gens ordinaires fabriquaient hier, aujourd’hui, ils l’achètent ; et ce qu’ils réparaient eux-mêmes, ils le remplacent intégralement, ou bien louent les service d’un expert pour le remettre en état, opération qui implique souvent le remplacement intégral d’un appareil en raison d’un dysfonctionnement d’une toute petite pièce.
Cet ouvrage plaide pour un idéal qui s’enracine dans la nuit des temps mais ne trouve plus guère d’écho aujourd’hui : le savoir-faire manuel et le rapport qu’il crée avec le monde matériel et les objets de l’art. Ce type de savoir-faire est désormais rarement convoqué dans nos activités quotidiennes de travailleurs et de consommateurs, et quiconque se risquerait à suggérer qu’il vaut la peine d’être cultivé se verrait probablement confronté aux sarcasmes du plus endurci des réalistes : l’économiste professionnel. Ce dernier ne manquera pas, en effet, de souligner les « coûts d’opportunité » de perdre son temps à fabriquer ce qui peut être acheté dans le commerce. Pour sa part, l’enseignant réaliste vous expliquera qu’il est irresponsable de préparer les jeunes aux professions artisanales et manuelles, qui incarnent désormais un stade révolu de l’activité socio-économique. On peut toutefois se demander si ces considérations sont aussi réalistes qu’elles le prétendent, et si elles ne sont pas au contraire le produit d’une certaine forme d’irréalisme qui oriente systématiquement les jeunes vers les métiers les plus fantomatiques. »
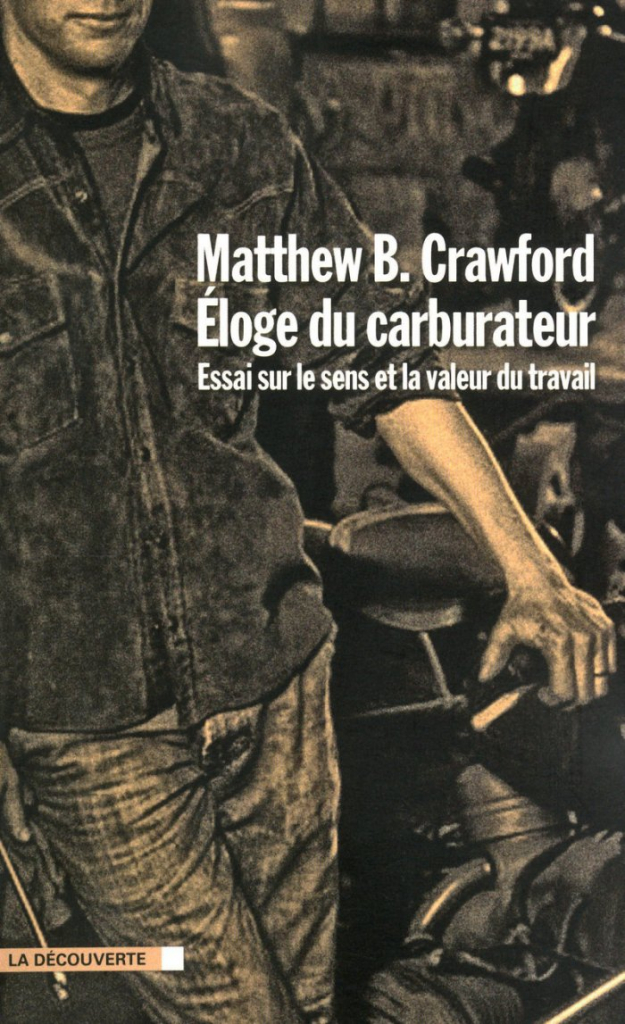
Plus loin, dans la même introduction, Crawford revient sur cette autre raison qui l’a conduit à écrire ce livre : sa propre expérience de mécanicien moto. Et il met de mots sur la qualité spécifique du travail qui était alors le sien :
« Quand je vois une moto quitter mon atelier en démarrant gaillardement, et ce quelques jours après y avoir été transportée à l’arrière d’un pick-up, toute ma fatigue se dissipe, même si je viens de passer toute la journée debout sur une dalle de béton. A travers la visière de son casque, je devine le sourire de satisfaction du motard privé de véhicule depuis un bon bout de temps. Je le salue d’un geste de la main. Une main sur la manette des gaz et une autre sur l’embrayage, je sais qu’il ne peut me rendre mon salut. Mais je déchiffre un message de gratitude dans la joyeuse pétarade du moteur qu’il emballe pour le plaisir. J’aime cette sonorité exubérante, et je sais que lui aussi. Ce qui passe entre nous, c’est une conversation de ventriloques au timbre mécanique, et le message en est tout simple : Ouaaaaaaaaais ! »
Voudrions-nous valoriser de nouveau le travail réel de ceux qui travaillent le monde, on serait attentif aux fruits de leur labeur, aux œuvres qui naissent entre leurs mains, au miracle de la réparation, à la magie de la création, à la sorcellerie de l’optimisation. Evidemment, il faudrait qu’on ne soit pas à ce point focalisé sur la seule consommation. L’argent n’est pas la seule rémunération du travail : trouver dans l’œil d’autrui l’écho de son propre travail parce qu’il est vu et apprécié, c’est l’autre paie que nous recevons. Il suffit pour cela qu’on dispose du temps nécessaire pour être attentif à ce que font les autres, et qu’on ne les méprise pas précisément parce qu’ils font quelque chose de leurs mains. Sans doute faut-il aussi que soi-même on ne soit pas noyé, 24h/24, par le travail nécessaire au gain de sa propre vie. Il faut, pour que le travail soit apprécié à sa juste valeur, que celle-ci ne se réduise pas à sa rémunération, qu’une part du travail au moins soit dégagée des exigences économiques, qu’on ait le temps de regarder ce que font les autres, et qu’ils fassent aussi ce qu’ils font pour que ce soit regardé.

A cette condition, cette relation décrite par Matthew B. Crawford entre un client et celui qui a travaillé pour lui peut exister. Et sans aller jusqu’à parler de famille commune, c’est bien une forme de communauté qui se crée dans ces échanges : on voit ce que l’autre fait, et celui qui travaille se voit regardé travailler, pas au sens d’un regard inquisiteur et inspecteur, mais au contraire par un regard qui sait la valeur de ce qui est fait. Or seule l’intervention manuelle sur la matière permet une telle évidence et un tel partage. Un exemple récent le met en évidence, et il montre aussi que ce n’est pas une question d’argent : il se trouve que la petite AMI mise sur le marché par Citroën est bourrée de défauts. Désembuage asthmatique, portes qui s’ouvrent toutes seules en roulant, châssis mal soudé, infiltrations d’eau dans l’habitacle, vitesse maxi qui passe à 15 km/h quand il fait froid, autant de problèmes qui pourraient mettre les propriétaires sérieusement en rogne. Mais voilà : à la différence d’une e208 qui tombe bêtement en panne de traction et laisse son conducteur dans l’inconnu, la petite Citroën peut se bricoler. D’abord parce qu’elle est simple, ensuite parce que coûtant très peu, on envisage plus sereinement d’intervenir sur sa mécanique, sa carrosserie, son intérieur, en gros tout ce qui la constitue. Et comme par hasard, c’est une communauté de propriétaires et utilisateurs qui se crée autour de ce quadricycle, fondée sur la nécessité collective de bricoler l’engin pour le faire rouler. Et par la même occasion ce sont aussi des connaissances qui se tissent, des réseaux d’entraide, de partage de combines qui se créent et s’entretiennent. De ce petit fourmillement émergent des figures, tel Gaëtan Colombiers, qui crée des pièces 3D pour améliorer le quadricycle Citroën et en partage les fichiers afin que chacun puisse, chez soi, imprimer les pièces à son tour.
On imagine tout à fait un père de famille bricolant dans l’allée de la maison ou dans le sous-sol de l’immeuble une AMI avec ses gamins. Se transmet alors la pratique de la débrouille, l’art du démontage, de l’observation, de la recherche de problèmes, et les techniques visant à leur résolution. Il n’est pas étonnant que, dans une forme un peu prolongée, Matthew P. Rojas ait proposé un montage de son spot pour Lokey’s Body Shop qui met en scène un gamin observant le monde depuis la place arrière d’un SUV, tenant entre ses doigts une voiture miniature. Ce n’est pas étonnant aussi que ce même montage fasse à ce point le lien entre les patrons du garage et les jeunes employés qui y travaillent. Il y a dans les savoir-faire quelque chose qui réclame, pour qu’ils soient correctement transmis, un savoir-être qui se reconnaît dans l’aptitude à miser sur un temps tellement long qu’il dépasse ce qui nous reste à vivre. Et c’est précisément parce qu’il nous reste peu à vivre qu’il est nécessaire de transmettre.
Un garage est une affaire, évidemment, et un patrimoine qui se gère, qui doit un jour se transmettre. Mais plus précieuse que les murs, les machines-outils, les pièces en stock et les voitures sur les ponts, il y a une richesse qui se perd si elle n’est pas partagée, un capital qui se multiplie au fur et à mesure qu’on en fait don : c’est le savoir-faire, la vie quotidienne passée, jour après jour, à côtoyer les pièces mécaniques et à entretenir avec elles une intimité qui permet de les connaître véritablement, et d’en faire quelque chose. Ce savoir est cette part de la culture qui n’est pas transmise à l’école, parce qu’elle est dépréciée. Et sil elle l’est, c’est parce qu’elle ne semble pas immédiatement et suffisamment rentable pour qu’on puisse oser envoyer des jeunes dans cette direction.
L’une des ironies du monde automobile, et pas la moindre, c’est qu’il est l’affaire d’un groupe de personnes qui sont évidemment plus intéressées par les investissements à fort rendement que par les métiers manuels. Et ce goût est souvent relayé par ceux-là même qui affirment être de véritables amateurs de bagnoles, parce que c’est tout de même un loisir dont la représentation est très bourgeoise. Or c’est précisément ce goût pour la richesse qui tue, à petit feu, la possibilité pour l’automobile réelle, c’est à dire celle qui existe déjà, celle qui pourrait être entretenue, réparée, mise à jour, adaptée au temps et aux usages présents, d’exister. Un jour, il faudra que dans l’esprit des bagnolards la culture auto et la culture politiques se mettent, un peu plus, en phase.
C’est là le prix à payer pour qu’on puisse encore prendre plaisir à voir évoluer, libre et simple, une Chevrolet Chevelle sur une route secondaire. Parce qu’il faut bien que des mécanos soient disponibles pour les réparer, parce qu’il faut bien que leur travail soit économiquement accessible, parce qu’il faut bien qu’ils soient formés, et qu’ils aient des garages qui les emploient, qu’une économie compatible avec leur activité perdure. Il faut pour cela être sensible à autre chose que la stricte performance, et la seule rentabilité. Il faut finalement développer le goût de la beauté.
