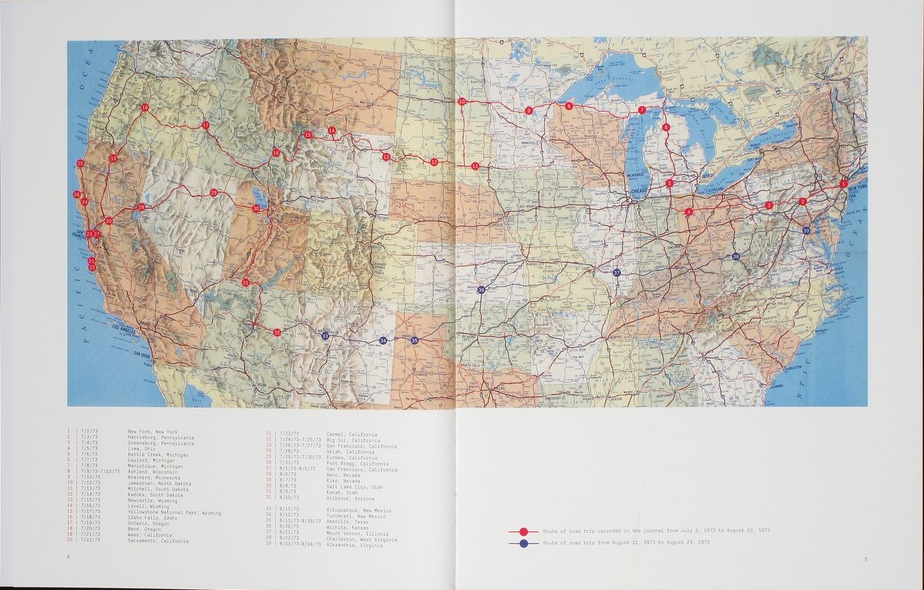Parce que l’objet est massif et spectaculaire, l’automobile saisie en photographie a tendance à focaliser toute l’attention, et prendre toute la place dans le cadre. C’est évidemment le cas dans la photo publicitaire, mais la voiture s’impose aussi dans les cadrages de la « photographie d’art », comme chez William Eggleston, où elle devient parfois le centre de l’attention, le point focal de la photographie, s’installant au premier plan ou au beau milieu de la composition.
Banalités
Mais sur un continent américain où l’automobile est à ce point répandue, en faire un objet central, et donc à part, détaché du décor, ce serait l’installer à une place qui n’est pas la sienne. La voiture n’est pas, en tant que genre d’objet, indépendante de l’univers qui l’a fait naître. Et si la genre à part entière qu’est la voiture américaine est si important dans l’histoire de l’automobile, c’est précisément que nulle part ailleurs que dans cet espace l’automobile ne se trouve davantage dans ce qu’on pourrait appeler son « élément ». Ainsi, peut-être le regard le plus juste qu’on puisse porter sur la voiture américaine consiste à se focaliser sur sont côté spectaculaire, mais au contraire à voir en elle quelque chose de banal, comme une forme qui émerge naturellement, et nécessairement de la configuration des lieux, tout comme les lieux sont le résultat de sa présence : urbanité et automobile sont, sur ce territoire, deux formes naturelles conjointes, symbiotiques, qui délimitent et rendent possible la vie quotidienne. Et autant, chez nous, il peut y avoir des débats sur la possibilité de se passer de la voiture, autant aux Etats-Unis une telle question ne se pose même pas. Effacer l’automobile, ce serait rayer de la carte tout ce qui va avec. Autant annoncer la disparition pure et simple des USA.
Quand on parcourt l’oeuvre de Stephen Shore, on est surpris par un phénomène en apparence ambigu, qui trouve pourtant ses raisons dans ce que je viens d’évoquer : l’automobile y est quasi omniprésente. Et pourtant, elle n’est jamais l’objet de la photographie, et ce y compris quand elle est au centre de la composition. A vrai dire, quand bien même ces photographies sont figuratives, on aurait du mal à dire quels en sont les objets. Et c’est peut-être là le signe des grands photographes : on ne sait pas de quoi leurs photographies sont les photos. Ce sont, juste, des photographies. Et c’est le cas des oeuvres de Stephen Shore. Privilégiant les plans larges sur des univers urbains n’ayant pas de caractéristiques particulières, il évite les lieux qui méritent le détour. A la différence de la pratique photographique populaire contemporaine, il ne donne jamais l’impression de s’être déplacé pour prendre une photographie à tel endroit. En revanche, une évidence : il ne déclenche pas l’obturateur n’importe quand, car la lumière joue dans son oeuvre un rôle fondamental, découpant le réel au rasoir, traçant des cadres d’ombres allongées dans le cadre de la photo, créant d’immenses frontières immatérielles et pourtant visibles dans les avenues, les carrefours, les parkings. Ainsi, les espaces avant tout caractérisés par leur banalité deviennent-ils singuliers, uniques, et simultanément, universels. Un univers offert au regard. Et la photographie a ceci de particulier que c’est le regard d’un seul à l’instant du cadrage, du déclenchement et du tirage, qui devient, dès que la photographie est regardée, un regard partagé. Dans le cas de Stephen Shore, ce phénomène est d’autant plus évident que les angles, les hauteurs de prise de vue sont celles du commun des mortels. A vrai dire, tout dans sa photographie est, justement, d’une grande banalité, et c’est là ce qui ouvre à son oeuvre la possibilité d’un partage sans limite.
Aussi ne faut-il pas regarder ses tirages comme la représentation d’une vision pittoresque de l’Amérique. Sans doute passerait-on à côté de ce à quoi ces paysages urbains invitent. Au contraire, il faut puiser en nous tout ce que nous contenons d’images déjà présentes, issues des séries et films venus d’outre-Atlantique, il faut entretenir tout ce que nous pouvons avoir de commun avec l’américain pour que l’expérience des photographies de Stephen Shore soit saisissante de banalité.
Il y a un penseur qui, en France, a particulièrement bien parlé de ce photographe, à tel point qu’à vrai dire, il m’a un peu ouvert les yeux sur son oeuvre : Bruce Bégout devrait être lu par tous ceux qui s’intéressent à l’automobile, précisément parce qu’il ne s’attache pas du tout à l’objet technique qu’est la voiture, mais à l’expérience dont elle est le véhicule et à la façon dont l’espace de nos vies est structuré, tissé à partir de ce moyen de s’y déplacer. Et ce qui l’intéresse sans doute plus encore, dans le fond, c’est la façon dont ce déplacement révèle quelque chose de profondément juste quant à ce qu’est, pour nous, ce que nous appelons « le monde ». C’est pourquoi on trouve chez lui l’amorce de ce qu’il appelle une « théorie du cruising », et les dernières pages de son dernier livre, Los Angeles, capitale du XXe siècle, sont consacrées à l’essence profondément automobile de Los Angeles, et aux liens, essentiels, qu’on peut discerner entre la voiture et le cinéma. Ainsi, les toutes dernières pages du livres déploient une analyse courte, mais d’une grande finesse, sur le road-movie. Et à vrai dire, une fois lues ces quelques pages, je me demande bien ce que je vais pouvoir écrire de mieux sur le sujet.

Mais c’est dans un livre plus ancien que Bruce Bégout évoque Stephen Shore. En fait, il fait mieux que l’évoquer. Il tente carrément d’habiter sa photographie. Et c’est là le point de départ de ce texte, qui est un des petits segments qui composent son très beau livre, L’Eblouissement des bords de route. Ce petit chapitre s’intitule :
L’intégralité de l’objet vu
« Depuis le jour où je les ai vues, j’ai toujours voulu vivre dans une des photographies de Stephen Shore. Au centre de ces paysages suburbains où parkings, stations-service, motels et centre commerciaux composent une ville neutre et fugitive, il me semble que j’aurais pu refaire ma vie. Rien n’aurait été plus facile. Tout est visible dans n’importe quel cliché grâce à la précision des lieux, au contour net des personnages, à la définition des objets. Comme des vêtements dans une vitrine, des vies prêtes à être vécues attendaient là, silencieuses et figées, qu’un spectateur fasse attention à elles et les revête. J’aurais pu être cet homme quelconque qui, par le simple pouvoir de son imagination, n’aurait eu qu’à se glisser dans le décor des sollicitations inassouvies pour se sentir immédiatement à son aise, comme en symbiose avec la banalité absolue du site. Tel le Dieu de Descartes qui met en branle l’univers d’une simple chiquenaude, le laissant poursuivre seul son mouvement perpétuel, il m’aurait suffi d’animer très légèrement l’image pour que tout se mette à bouger définitivement.
Si j’avait eu à choisir parmi la série des Uncommon places, j’aurais sans doute opté pour Marland Street, Hobbs, New Mexico. Je me vois déjà ouvrant le portail de l’enclos qui enserre la piscine du Hobbs Lamp Lighter Motel, contourner le bassin bleu Hockney et m’installer sur une chaise en osier, dos à la route. J’aurais pu amener un livre ou deux, faire quelques brasses, observer la rue toute proche avec son bric-à-brac d’incitations commerciales et de signalisations qui ne mènent nulle part. J’aurais pu me perdre dans la contemplation d’une femme en train d’ouvrir le coffre de sa voiture sur le parking latéral du Lowden lounge pour en extraire un sac en plastique noir – personnage aussi énigmatique que la nymphe canéphore qui fait irruption dans La Vie de Saint Jean-Baptiste de Ghirlandaio. Dans celle d’un homme en costume noir longeant le mur de briques de la Cathey Company, comme s’il tenait à s’effacer à mesure qu’il avance. Ou dans celle d’une Buick marron qui cale au milieu de la route et s’immobilise un moment, sans que l’on puisse deviner ce qui se passe à l’intérieur. Tant d’événements insignifiants qui passent complètement inaperçus dans la vie courante, mais qui acquièrent une visibilité totale par l’attention qu’on leur porte. Les photographies de Stephen Shore représentent des paysages-pièges devant lesquels on ressent une impression contrastée : soit les fuir du regard, soit s’abîmer en eux, au risque d’en rester prisonnier toute sa vie.
Devenu un personnage de la photographie, j’aurais pu faire la rencontre d’autres clients du motel : le vieux couple à la retraite qui traverse le pays pour aller voir ses enfants dans le nord-ouest, le touriste qui trouve tout étonnant ou barbant, la famille mexicaine qui se baigne dans la piscine en tee-shirt sans aucune pruderie. J’aurais pu également choisir de m’installer ici, prendre une chambre à l’année, ne plus rentrer en France. La vie dans le motel aurait constitué pour moi un exercice de détachement, une forme d’ascèse corporelle et mentale, de mise à distance du monde, des autres et de soi, pour concorder enfin avec la présence pure de l’instant sans mémoire ni espoir.
J’aurais pou décider de me défaire du jour au lendemain de mes obligations familiales et professionnelles, de renoncer à tous les avantages de ma situation, de mettre à nu mon existence au point de ne plus tenir à rien. J’aurais pu arrêter de penser, d’écrire, de publier, j’aurais pu prendre un petit boulot rébarbatif et sans intérêt où j’aurais subi sans rien dire les vexations du sort, comme pour me guérir de la maladie du sens. Voilà ce que j’aurais pu vivre dans une photographie de Stephen Shore et qu’en un certain sens j’ai déjà vécu ».

Phénoménal
Evidemment, quand on sait que celui qui écrit ces lignes est, aussi (et non par ailleurs, parce que son travail semble, de plus en plus, être un ensemble cohérent), un fin connaisseur de Husserl, on se dit que cette façon de mettre à distance le monde – en ne cédant pas à la tentation de l’abstraction, mais au contraire en baignant dans une photographie tellement détaillée du monde banal qu’elle évoque évidemment les prouesses picturales de l’hyperréalisme et du pop-art donc Stephen Shore était si proche – cette tentative pour mettre la réalité du monde entre parenthèses sans pour autant évacuer l’expérience du monde, fait beaucoup penser au retrait, aussi appelée épochè, dont Husserl voulait faire sa méthode. Le regard que ces photographies portent sur le monde est, comme on dit en philosophie, phénoménologique. Une façon d’entériner pour de bon que ce dont nous faisons l’expérience, ce n’est pas l’être en soi, mais le phénomène, qui est ce dont l’être a l’air quand on y est. Il s’agit de saisir le monde pour ce qu’il est pour nous : une apparition. Et comme, a priori, il n’est que pour nous, on peut dire qu’il n’est qu’apparition. Il y a quelque chose de profondément vertigineux dans une telle tentative, comme si dans Matrix, les habitants de ce qu’on appelle usuellement « le monde » prenaient conscience de l’artificialité du décor dans lequel ils évoluent, mais renonçaient pourtant à affirmer quoi que ce soit à propos de ce qui se tiendrait au-delà de cette surface.
Si on y réfléchit un peu, le pop-art fut une tentative de coller au plus près à cette surface, en s’interdisant le plus possible de creuser au-delà de l’apparence. Les photographies de Stephen Shore ne le montrent pas, mais elles appartiennent à ce projet esthétique. Intégré à la Factory, le camp de base d’Andy Warhol, il a réussi à développer un style qui lui est propre, qui n’affiche pas d’emblée l’ironie qui semble caractériser de nombreuses œuvres de ce courant. Il ne prend pas le monde de haut. Au contraire, il le regarde à hauteur d’homme, sans enfermement, en laissant de chaque côté des carrefours le monde se déployer le long de perspectives qui ont ceci de non particulier : nulle part, l’ailleurs ne semble avoir plus, ou moins de valeur que l’ici : sur cette surface infinie, tout est égal.

De l’automobiliste à l’autonaute
Quelle est, dans un tel monde, la place de la voiture ? Une place banale, évidemment. Comme on l’a dit pour commencer, la bagnole, chez Stephen Shore, n’occupe pas une place centrale, parce que rien, dans le monde qu’il donne à voir, n’a de centre, pas même la ville. La voiture est une banalité parmi d’autres. Elle est même un moteur de cette banalité. On pourrait, ici, se dire qu’il est paradoxal, quand on est un peu bagnolard, d’être ainsi fasciné par des photographies qui banalisent ainsi l’objet de sa passion. En réalité, ce n’est pas un paradoxe, et c’est même, peut-être, une perspective. Il y a, bien sûr, une part de soi-même qui est attaché à la connaissance, la contemplation et parfois même la conduite de tel ou tel modèle, qui a des caractéristiques précises, et permet une expérience singulière. Mais l’automobile est, aussi, un objet générique qu’on peut apprécier en tant que telle, en se foutant complètement de la marque, du modèle, des caractéristiques de la voiture dans laquelle on va monter. Il s’agit alors, simplement, d’apprécier le mouvement automobile pour lui-même, et de se laisser pénétrer par l’expérience de la conduite dans ce qu’elle peut avoir de plus banal.
Et c’est dans cette seconde option que se trouve la place de la voiture dans le monde de Stephen Shore : rouler sans but (puisque les lieux sont égaux), se déplacer dans le tissu urbain comme une navette dans un métier à tisser, de façon régulière et indifférente, ne plus chercher à percer le mystère de la surface urbaine mais en éprouver, au contraire, la pure superficialité, c’est exactement ce que permet l’errance automobile. Quand on conduit sans but, et sans se concentrer particulièrement sur les sensations mécaniques, alors le monde apparaît comme un flux permanent défilant sur les surfaces vitrées. On ne peut s’attacher durablement à aucun des détails filant sur l’un des quatre écrans qui encadrent l’habitacle. L’automobile traverse le monde sans le toucher, indifférente, dans un univers devenu indifférencié. Si ce n’est pas le genre d’émotion que cherche habituellement le passionné d’automobile, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit, pourtant, d’un mouvement qui est, absolument, automobile (Bruce Bégoût parlerait, lui, d’autonautisme). Sans doute plus fermement ancrée dans la conduite à l’américaine de paquebots lents, coupleux, dont la boite de vitesse se gère toute seule, coude à la portière, il n’est pas étonnant que cette façon d’envisager l’automobile soit plus facile à saisir outre-atlantique.

Autodrive
Mais une certaine évolution de l’automobile, en Europe comme ailleurs, entrouvre aussi cette porte, que beaucoup considèrent comme hostile à l’automobile : les véhicules autonomes, qui dessaisissent le conducteur de son rôle de pilote, prenant la main sur les trajectoire, la vitesse, bref, tout ce qui mettait en scène la virtuosité de celui qui avait le volant en mains. Cette perspective n’est pas la fin de l’expérience automobile, parce que celle-ci n’a pas pour essence la conduite, mais le déplacement, la translation au beau milieu d’un monde d’images en mouvement. Ce qu’on perdra en sensations de pilotage, on le gagnera en justesse de rapport au monde.
Il n’est donc pas étonnant qu’on trouve chez Bruce Bégout le témoignage intime de l’état particulier dans lequel le mettent les photographies de Stephen Shore, ainsi qu’une méditation de plus en plus approfondie sur l’essence de ce qu’il appelle (à juste titre) le cruising. Ce qu’il indique ici, c’est qu’une quête philosophique contemporaine (c’est à dire attentive à ce qu’on appelle le « phénomène », c’est à dire ce au-delà de quoi il est sans doute illusoire d’aller) peut trouver son aboutissement dans la contemplation d’une photographie, et que le noyau de cette forme de pensée qui est, techniquement, inaccessible au plus grand nombre (parce qu’elle est peut partagée, en réalité), peut être approchée dans une expérience simple, consistant à se laisser aller au mouvement automobile, dans sa plus grande banalité, et à laisser l’image de ce monde défiler sur le pare-brise, et les fenêtres, en réalisant que ce que nous appelons « le monde », n’est rien d’autre que ce flux.
On découvre alors, si on veut bien se laisser aller de ce côté ci de l’expérience automobile, qui n’est évidemment pas celle que promeuvent ni les revues spécialisées ni les brochures publicitaires, que la voiture demeure – quoi qu’en disent ceux qui verraient d’un bon œil sa disparition pure et simple – ce qui connecte de la façon la plus juste l’homme et le monde que, par elle, il habite. Parce qu’elle est l’écran suprême, le seul qui ne mette pas à distance ce dont il offre la représentation, elle demeure le dispositif qui nous permet, en nous mettant en mouvement à la surface du monde, d’initier le mouvement du monde au plus profond de nous. Si on regarde encore un peu les vues urbaines de Stephen Shore, on retrouve cette étrange impression : les automobiles qu’on y croise, garées ça et là dans le paysage sont, finalement, autant d’invitations à plonger dans cette mise à plat sans fin

Pour les amateurs, depuis 2014, Stephen Shore photographie en numérique et partage ce qui est la continuation de son oeuvre sur son compte Instagram. Ceux que ça intéresse pourront méditer sur cette façon de prolonger son regard sur la banalité en investissant cette application qui est peut-être, aujourd’hui avec l’automobile l’autre révélateur de la profonde superficialité du monde. On y croise, de temps en temps encore, un carrefour urbain, et quelques voitures :
https://www.instagram.com/p/oRVhojx2KB/
Et en complément, une petite galerie de son travail urbain :