Faire salon
Qu’est ce qu’un salon de l’auto ? Une mise en scène permettant de faire se rencontrer ceux qui s’intéressent, et parfois aiment carrément les voitures, et les voitures elles-mêmes. Ceux qui désirent, et ce qu’ils croient être l’objet de leur désir, ignorant que l’objet du désir se trouve toujours un peu au-delà de ce qu’on vise. Et puisqu’il s’agit d’une mise en scène, on embauche quelques entremetteurs, qui se tiennent prêts, sur chaque stand, à accueillir les prétendants, et leur démontrer que, décidément, ce modèle est un rudement bon parti.
Les doutes écologiques aidant, et l’affaire Weinstein contraignant, cette année les hôtesses de stand ont quasiment disparu, laissant place à des êtres humains nettement plus habillés et nettement moins affriolants ; à moins que – et c’est tout à fait possible – on soit tout excité à la moindre conversation d’ordre mécanique, ce qui tomberait plutôt bien, puisque sur le stand BMW, les hôtes et hôtesses étaient carrément hyper pertinents, capables de parler en profondeur des caractéristiques techniques des modèles de leur marque, ce qui tombait presque mal au moment où la nouvelle série 3 était présentée, dans une gamme qui semblait comme amputée de deux cylindres. Autant dire qu’il fallait des interlocuteurs balaises en rhétorique mécanique pour enchanter le visiteur.

Petites mains
Mais il y a une rencontre qu’un tel salon ne peut organiser, c’est l’entrevue entre le client potentiel et ceux qui, loin des projecteurs, et parfois fort, fort loin dans le monde, fabriquent de leurs mains l’incroyable assemblage de pièces de tous genres qui constitue une automobile. C’est d’autant plus vrai dans une période où il s’agit de réenchanter un objet qui a perdu de sa superbe, chacun prenant conscience que ce monde, plus on s’y déplace, plus on l’explore, plus on le détruit, aussi. Dès lors, on cache l’usine, parce qu’on y devine un peu trop la débauche de matériaux et d’énergie qu’exige la construction d’une automobile. On préfère montrer les modèles en extérieur, chevauchant librement une planète sans barrière, pleine de mouvement et d’énergies ne réclamant qu’une chose : se dépenser.
Autant dire qu’on est loin de rendre hommage aux ouvriers qui sont les assembleurs des voitures qu’on préfère nous montrer comme si elles sortaient comme ça, toutes faites, de la presse à métal. Même la vidéo que BMW a mise en ligne, montrant la chaîne de montage de la nouvelle série 3, place les êtres humains au second plan, comme témoins d’un processus qui pourrait parfaitement se dérouler sans eux, comme si la production d’une BMW n’était plus une affaire d’hommes, mais de machines, quelque chose qui ne nécessiterait aucun effort, les BM venant au monde, comme au jardin d’Eden, sans forceps et sans dépense d’énergie.
Pourtant, on sait que c’est faux. Il y a toujours des hommes qui sont attachés à la mise en oeuvre des machines, des installateurs, des réparateurs, des hommes et des femmes qui sont aux petits soins pour la chaîne de montage, qui vivent à son rythme, veillent à son chevet, 24h/24, tout comme il y a des petites mains dans tous les services intermédiaires qui font que, finalement, les berlines BMW seront bien vendues et livrées à leur acheteur, et ce sans faute. On l’a vu quand Tesla a voulu automatiser excessivement ses lignes de montage pour produire sa Model 3 : les hommes demeurent une pièce mécanique nécessaire dans la machine.
Cette dissimulation des êtres humains qu’on met au service de la production et de la vente des automobiles n’est pas nouvelle, et peu nombreux sont ceux qui ont tenté de mettre en lumière ces hommes et femmes de l’ombre. Un film, pourtant propose un tel crash-test entre le salon et l’usine.

Faire entrer l’usine au salon
En 1972, Louis Malle se rend dans les usines Citroën dans lesquelles on fabrique à la chaîne la GS. Il trouve là la matière d’un long métrage, intitulé Humain, trop humain, dans lequel il prend le temps de filmer les ouvriers de près, suffisamment pour qu’on puisse côtoyer leurs gestes, la répétition des mêmes tâches. Mais, au lieu de se contenter d’une suite d’images prises dans l’usine, le film bifurque brusquement au salon de l’auto, où les clients jaugent les voitures, si semblables aux ouvriers, et si distants pourtant dans leur envie de les consommer, ces bagnoles. On passe ainsi un long moment à écouter les commentaires des uns et des autres sur les voitures avant qu’une hôtesse, sur son stand, dans un bâillement à se décrocher la mâchoire, exprime la lassitude d’être, elle aussi, au travail. Elle fait ainsi la transition vers le retour à l’usine, où on va retrouver les ouvriers au travail, cette fois ci avec, en mémoire, l’image du produit. On a envie, ensuite, de dire « tout ça pour ça ». Mais on a là la synthèse des deux versants de nous mêmes, tels qu’on ne pouvait pas tellement déjà en avoir conscience dans les années 70 : on croit alors qu’on est un temps producteur, et un temps consommateur. Nous savons aujourd’hui que bien qu’alternant entre ces deux postes, nous ne sommes qu’un seul et même agent du marché. Dans sa structure et dans ces visages, Humain trop humain en est, déjà, l’image.
On ne peut pas regarder ce document sans avoir une attention particulière pour ces ouvriers particuliers que sont les ouvrières. La quasi totalité des plans qui les mettent en scène sont une énigme : on n’a aucune idée de ce qu’elles font. Et on a beau regarder, on ne parvient pas à déterminer ce que c’est qu’elles ont entre les mains, qui est pourtant censé être l’outil, ou le fruit de leur travail. L’ouverture du troisième temps du film, qui met en scène cette femme qui plie des tiges de métal selon un gabarit qu’elle a en permanence en mains, est un grand moment d’incertitude : que fait-elle ? Nous ne le savons pas, et nous ne le saurons pas. Mais le sait-elle, elle-même ? On ne le saura pas non plus, parce qu’en fait, cela importe peu : elle peut parfaitement faire ce qu’elle fait sans savoir ce qu’elle fait. Elle pourrait même le faire sans savoir que cela participe à la construction d’une voiture. Ce n’est qu’une suite de gestes, qu’il s’agit de répéter à l’infini, tels que le gabarit impose de les exécuter. N’importe qui pourrait faire ceci, parce que ça pourrait être, en fait, n’importe quoi.Ici, l’essence de l’ouvrier, qui consiste en l’aptitude à œuvrer, est proprement niée. La simple exécution de taches est une aliénation du travail véritable, au sens où elle en est la négation, l’envers; le négatif. Ça ressemble à première vue à du travail, ça en a la lointaine apparence, mais c’est en réalité autre chose que du travail, c’est l’exécution d’une tâche, pour laquelle les ouvriers ont été programmés. Ils font acte de présence, parce que ce qui doit être fait nécessite le support de leur corps. Mais à strictement parler, ils ne sont pas vraiment là, et il n’y a dès lors rien de plus humain dans l’usine Citroën des années 70 qu’il n’y a de présence humaine sur la ligne de montage BMW en 2018.
En Marx
Reste un mystère : la seconde partie du film, qui abandonne l’usine de Rennes pour rôder Porte de Versailles, dans le parc des expositions où se déroule, en ce temps là annuellement, le Salon de l’auto. Entre temps, le non sens a gagné du terrain, et si les ouvriers se dépensent pour des intérêts qui ne sont pas avant tout les leurs, et si à la limite on peut comprendre qu’ils le fassent (ils n’ont pas vraiment le choix : leur vie ne leur appartient pas, sinon ils n’en seraient pas à devoir la gagner ), on s’aperçoit, devant ces plans saisis au Salon de l’auto, que le comportement des clients potentiels est au moins aussi mystérieux que celui des ouvriers. Tout d’abord, rappelons-le : ils ne gagneront rien à acheter telle voiture plutôt que telle autre. Quoi qu’ils achètent, ils perdront de l’argent, car rien ne se vend à perte. Si les vendeurs brossent le visiteur dans le sens du poil, c’est pour l’amadouer, pas pour le servir. Le client n’est jamais roi, car de roi, il n’y en a qu’un, que tous les clients ne peuvent pas l’être simultanément, et puis les rois se servent, ils prennent, ils s’octroient, ils pillent; mais ils ne paient pas. Du vendeur et de l’acheteur, c’est toujours le premier qui est gagnant, toujours lui qui pille l’autre. Proposons une description marxienne de ce processus : ce que Michelin, l’actionnaire, prend à l’ouvrier, il le prend aussi au client. Le client, lui aussi, aliéné, au sens où la vente ne se fait pas à son bénéfice. Reprenons la formule initiale, et détournons la : « L’achat n’est pas la satisfaction d’un besoin, mais seulement un moyen de satisfaire des besoins en dehors de l’achat » (on trouve cette belle formule de Marx dans ses Manuscrits de 1844, qu’on ne saurait trop conseiller de lire !). Si la marchandise est produite, il est nécessaire qu’elle soit consommée. Un manque qu’il est nécessaire de combler, c’est ce qu’on appelle un besoin. Dès lors, l’achat correspond bien à la satisfaction d’un besoin, mais ce n’est pas, dans le cas de la voiture, d’un besoin de motorisation qu’ils s’agit. Il ne s’agit jamais d’autre chose que d’un besoin d’écouler la marchandise. Rien d’autre dans le fond, quand bien ça semble être tout autre chose en apparence. A aucun moment, la voiture n’a été ni conçue, ni construite, ni vendue pour l’usage que le client allait en avoir. Ça, l’usage, c’était juste ce qui allait l’attirer sur ce stand ci plutôt que chez Peugeot. Mais la raison réelle de l’existence de la GS, ce n’est pas le transport de ses passagers, c’est le fait que, par elle, on détourne le désir mécanique, la nécessité de se déplacer, l’énergie des ouvriers, la valeur ajoutée à la matière première, le génie des ingénieurs pour transformer cela en valeur ajoutée, en bénéfice. La totalité du processus de production de la marchandise, dont l’achat n’est qu’un des rouages, a pour but d’aliéner des forces, des idées, de l’argent. Et si le client a l’impression d’être au centre de toutes les attentions, c’est seulement parce qu’il est une proie plus farouche, qu’il s’agit d’avoir tout particulièrement à l’oeil. Les ouvriers, eux, ils n’ont pas le choix, ils ne risquent pas de se sauver; ils sont captifs.
Evidemment, puisque théoriquement, ce blog s’adresse à des passionnés de bagnoles, on me répondra qu’enfin, j’oublie que la GS est, aussi, une espèce de concentré de génie technologique, une berline qui, à l’époque, ne ressemble à aucune autre, la démonstration que, justement, l’esprit humain peut dépasser les simples considérations marchandes et se lancer dans des défis gratuits, pour la seule beauté du geste. Certes, la GS, c’est bien cela. Pour les ingénieurs, et pour ceux des ouvriers qui savent ce à quoi ils participent, une GS, c’est cette oeuvre commune issue de l’inventivité des ingénieurs, du coup de crayon de ses designers. Mais pour l’actionnaire, Michelin, c’est un investissement, qui ne sera pas considéré comme suffisamment rentable. Ainsi, quatre ans après ce film, Citroën est vendue à Peugeot, qui en fera une marque vouée à commercialiser des ersatz de ses propres modèles, inventant le low-cost avant l’heure. Autant dire que les ingénieurs qui faisaient la spécificité de la marque aux chevrons comprirent alors quelle était la véritable nature et le véritable objectif d’un travail qui, dès lors, ne semblait plus être le leur, et qui d’ailleurs, puisqu’ils le vendaient, ne l’avait jamais été.
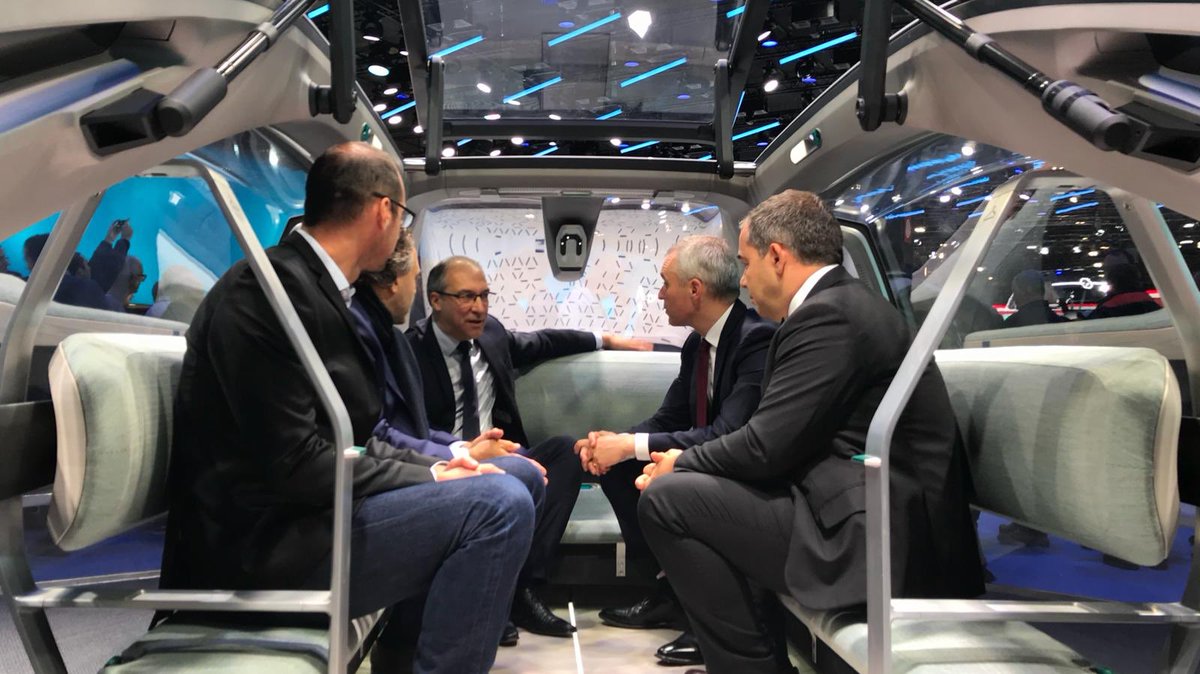
Un fric de fou
En somme, la consommation est tout aussi aliénante que la production ; il s’agit toujours d’être possédé, de se faire avoir. Si on regarde la seconde partie de Humain, trop humain, dans cette perspective, ça semble sauter aux yeux : les discours tenus ne servent qu’un seul projet, se persuader soi-même qu’on fait le bon choix, qu’on a le sens des affaires, ce qui pour le client relève toujours de l’illusion. Si on observe correctement, on s’aperçoit qu’il se passe quelque chose de très étonnant : en fait, les visiteurs font carrément le boulot des vendeurs, qui n’ont plus qu’à les regarder faire. De la même façon que les clients des supermarchés sont capables de faire gratuitement le « travail » de la caissière, sous son nez, les visiteurs du salon de l’auto font l’article des modèles, mieux que s’ils étaient payés pour le faire. C’est normal, en fait : plus que le vendeur, c’est le client qui a besoin d’être persuadé que ce qu’il fait, il le fait pour lui. Et s’il a besoin de s’en persuader, c’est précisément parce que dans le fond, il sait que ce n’est pas le cas. L’achat n’est supportable, en tant qu’acte aliénant, que dans la mesure où il se drape dans la fausse dignité de la bonne affaire, de la négociation avantageuse. Croire que l’achat relève du pouvoir, c’est se raconter des histoires. L’achat est tout aussi contraint que la production, c’est un acte aliéné, et aliénant au même titre que le travail ouvrier tel que Marx le décrit. Il n’y a pas de pouvoir d’achat.
Il est temps, maintenant, de passer à l’usine, puis au salon :